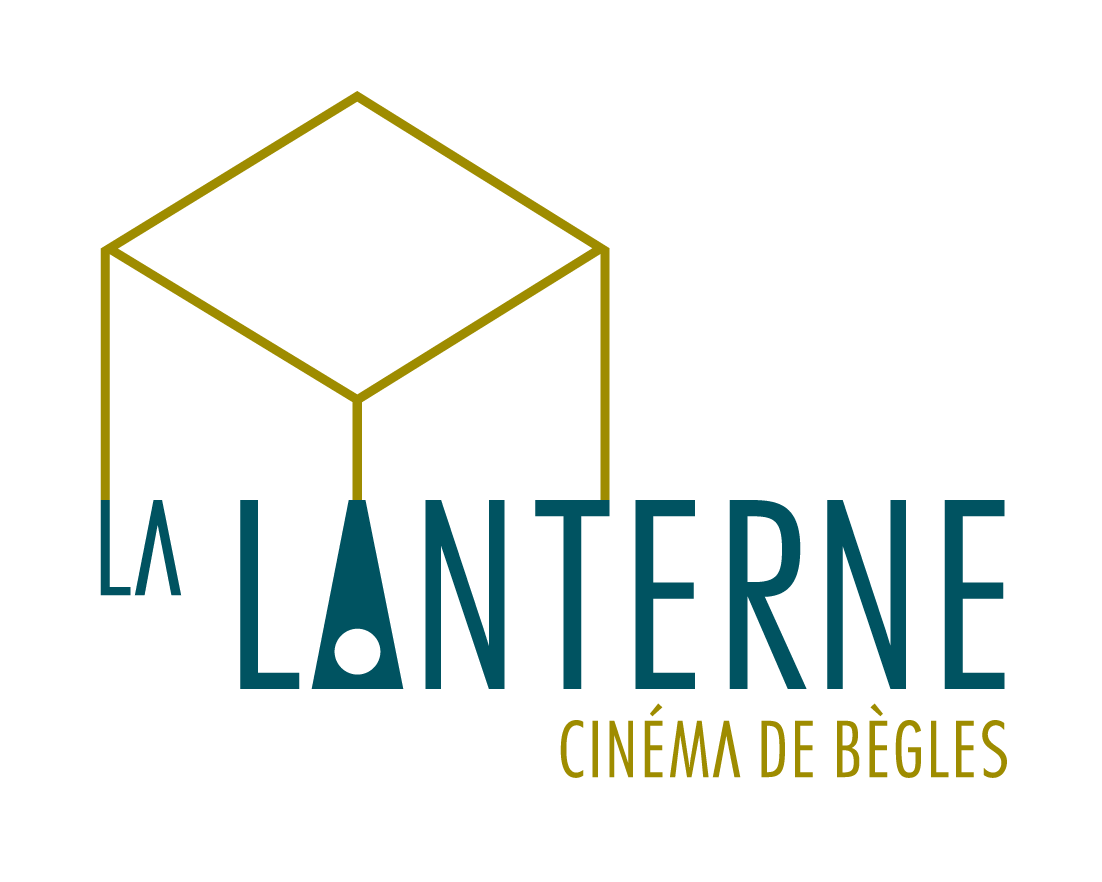TU NE MENTIRAS POINT
Réservation : pour acheter votre place à l’avance, cliquez sur l’horaire de la séance
“Tu ne mentiras point” : Cillian Murphy bouleversant avec cette évocation des violences dans des couvents irlandais
Une dénonciation subtile et juste des pratiques de l’Église dans l’Irlande des années 1980, portée par une interprétation poignante.
Come on Eileen, le tube euphorisant des Dexys Midnight Runners entendu à la radio lors d’une séquence au pub, permet de dater l’action : le début des années 1980. Mais s’il fallait se fier aux seules images, Tu ne mentiras point (n’ayez pas peur, le film est plus subtil que son titre français !) pourrait aussi bien se dérouler vingt ou quarante ans plus tôt, tant son décor de petite ville portuaire engourdie par l’hiver, sa (superbe) photo où la lumière peine à raviver les couleurs nous plongent dans l’Irlande traditionnelle, sinon éternelle. Celle d’une société corsetée, dominée par une Église catholique omniprésente — quand le réalisateur filme en extérieurs, il y a toujours une croix, un bâtiment religieux dans le plan, ou les cloches appelant à la messe en fond sonore. À New Ross, personne ne se risquerait à critiquer le couvent local, dont les bonnes sœurs « ont le bras long ». Et pourtant…
En 2002, The Magdalene Sisters, de Peter Mullan, Lion d’or à Venise, avait révélé au grand public le système organisé de séquestration et d’exploitation des « filles perdues » (parce que enceintes hors mariage ou jugées rebelles), perpétré durant des décennies au sein des « couvents-blanchisseries » de la Madeleine. Tu ne mentiras point est, lui aussi, dédié aux 56 000 jeunes femmes envoyées dans ces institutions entre 1922 et 1998 pour « pénitence et réhabilitation », ainsi qu’aux enfants qui leur ont été enlevés pour être adoptés. Mais sa dénonciation est beaucoup moins spectaculaire.
Tim Mielants le suggère, davantage qu’il ne le montre, à travers les couloirs sombres du couvent qui évoquent le château d’un conte horrifique, alors que hors champ les bruits infernaux de la blanchisserie semblent provenir des usines du XIXe siècle, décrites par Dickens dans ses romans. Surtout, à la différence de Peter Mullan dans son film choc, au lieu des victimes, il place au centre du récit un témoin. Bill Furlong est le modeste patron d’une entreprise de charbon ; alors qu’il effectue une livraison, il voit une adolescente être confiée de force par ses parents aux mauvaises mains des religieuses. La scène, traumatisante, le renvoie à son propre passé d’enfant illégitime dont la très jeune mère n’a dû son salut qu’à la générosité et à la tolérance d’une riche propriétaire terrienne. Bill sera-t-il, à son tour, un bon samaritain ?
Le film, malgré des flash-back parfois un peu appuyés, décrit avec une grande justesse la prise de conscience de cet homme ordinaire, qui aurait tout à perdre à bousculer l’ordre établi : ses deux filles aînées ont été admises au lycée géré par le couvent, et ses trois cadettes pourraient les suivre. Cillian Murphy, au jeu très retenu, tout en silences et gestes douloureux, est poignant. Que le cinéaste le montre fuyant face à son épouse aimante mais moins scrupuleuse (Eileen Walsh, qui incarnait l’une des héroïnes « déviantes » de The Magdalene Sisters), puis tétanisé devant la froide détermination de la mère supérieure. Sœur Mary (Emily Watson, géniale, car terrifiante) n’a pas besoin de proférer des menaces explicites ni même d’élever la voix pour rappeler son pouvoir de nuisance. De quoi glacer le sang.
Telerama