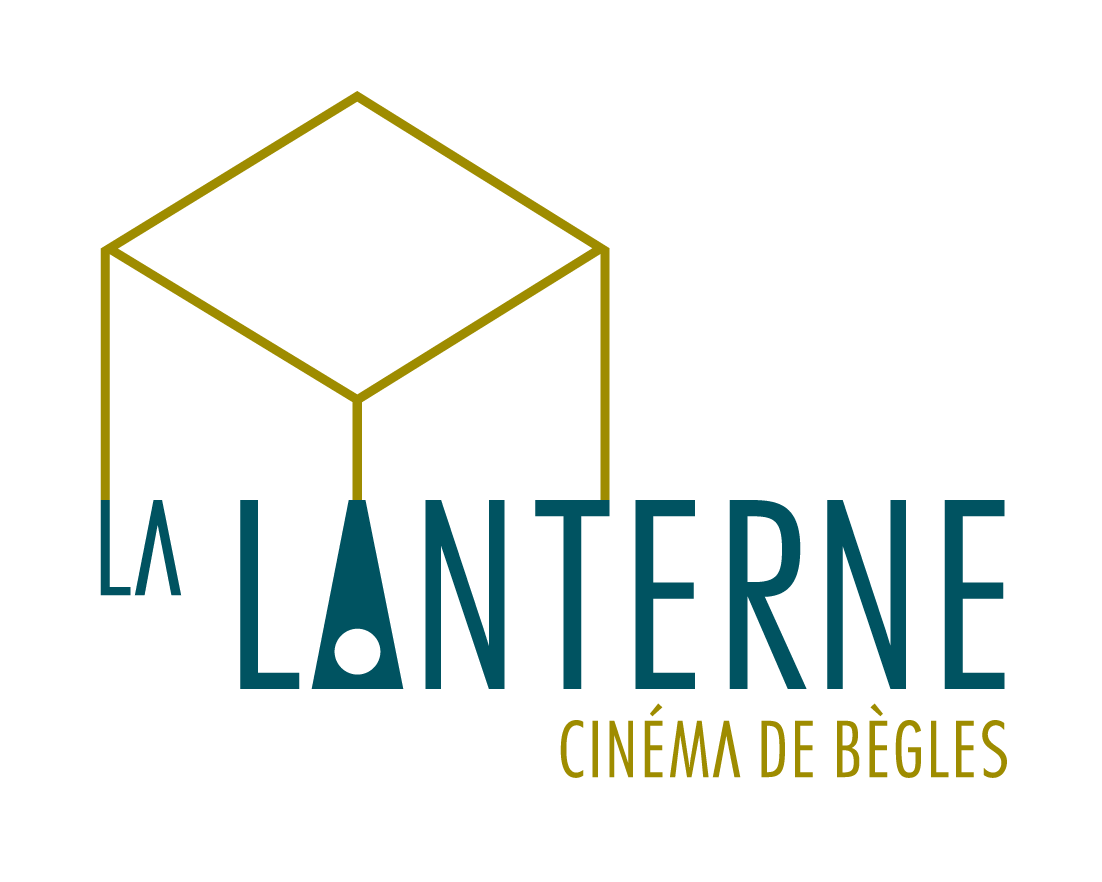JEUNESSE RETOUR AU PAYS
Réservation : pour acheter votre place à l’avance, cliquez sur l’horaire de la séance
Retour au pays synthétise d’emblée, par une réplique lapidaire, le rapport entre ouvriers et patrons circonscrit au fil de la trilogie Jeunesse. Après un tour de pâté de maisons embarqué sur une remorque tractée par une mobylette, grâce auquel la caméra quadrille un immeuble caractéristique de l’architecture du quartier textile de Zhili (avec ses étages effilés accueillant les ateliers, tandis que les échoppes sont au rez-de-chaussée), un ouvrier explique à la caméra qu’il ne parvient pas à se faire payer son solde. Puis lâche, dépité : « les patrons sont des bâtards. » Le trajet politique tracé par les deux premiers volets, entre des destins individuels cruels et de longues scènes de négociation sur le tarif des pièces, trouve dans cette formule son bilan. Les deux premiers films montraient en effet que la condition injuste de ces travailleurs issus de provinces plus ou moins lointaines et exploités par des entreprises privées en dehors d’un cadre légal, n’est quasiment jamais énoncée telle quelle par ceux qui la subissent. L’atmosphère carcérale des lieux semble dès lors enfermer à la fois les corps et les esprits. Si la réplique évoquée pourrait laisser espérer l’émergence d’une conscience politique plus affirmée, il faut davantage la prendre comme une résignation : les patrons sont des bâtards, on ne peut rien y faire.
C’est donc un dénouement amer qu’offre Retour au pays, même si Wang Bing semble vouloir l’adoucir en donnant une nouvelle place au segment consacré à l’échappée en dehors de Zhili, qui proposait une échappatoire aux travailleurs aussi bien qu’aux spectateurs des deux précédents films. Ce n’est plus dans l’épilogue (Le Printemps) ou dans le troisième quart (Les Tourments) que les ouvriers rentrent chez eux pour les festivités du Nouvel An, mais au bout de quarante minutes seulement. Cette ouverture précoce à la nature, sans avoir dans un premier temps enduré réellement le labeur des ateliers (car les séquences dans les ateliers sont ici plus courtes et ellipsées), distingue le film des deux premiers volets. En train, puis en minibus sur une route escarpée, le trajet d’un groupe vers la région du Yunnan revêt même une dimension vertigineuse. L’immensité des montagnes répond à la petitesse des chambres-cellules, tandis que la rudesse insensée de ce mode de vie (on s’exile pour mal gagner sa croûte ailleurs) apparaît de plus en plus nette à mesure que le voyage s’étire. Il ne reste, pour satisfaire aux traditions du Nouvel An chinois, qu’à allumer des pétards, dont les explosions toujours plus nombreuses émaillent le film (au point de confiner à l’effet burlesque). Elles servent conjointement de catharsis et de réceptacle à une forme de mélancolie : quand le bruit se dissipe et que la fumée et les débris de papier envahissent le cadre, Wang Bing fait durer les plans pour capter la chute de l’euphorie.
Retour au réel
Si Wang Bing s’est imposé depuis À l’ouest des rails comme l’un des documentaristes s’approchant au plus près des fluctuations d’un réel donné sans l’altérer par sa présence, cela tient sans doute à l’émergence simultanée du cinéma numérique au début des années 2000 : il est un homme à la petite caméra. Sa discrétion et celle de ses opérateurs (puisqu’il n’est aujourd’hui plus seul à tourner[1]) permettent de capter minutieusement une série de situations. Cette approche explique en premier lieu la fascination que ses films exercent, quoique la méthode du cinéaste fluctue légèrement au fil de son œuvre. À l’intérieur même de la trilogie Jeunesse, Les Tourments se démarquait par exemple par la présence accrue du filmeur, dont on apercevait par moments l’ombre, là où il était quasiment invisible dans Le Printemps, tandis qu’elle s’exprime dans Retour au pays d’une autre manière (par exemple, lorsque les parents des ouvriers filmés traitent l’équipe comme des convives). Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la capacité du documentariste à improviser un cadre selon ses intuitions au présent du tournage : quand s’arrêter en marchant, quand panoter pour filmer un protagoniste plutôt qu’un autre, quand suivre la direction d’un regard, qui accompagner à tel moment, etc. Wang Bing paraît toujours prendre la bonne décision, comme lorsqu’il choisit de ne pas cadrer l’une des explosions de pétards dans un champ, pour se concentrer sur les visages étonnamment inexpressifs des hommes qui les ont machinalement allumés.
Au-delà de cette qualité d’improvisation, particulièrement saillante lorsque les plans s’installent dans la durée, le film fait également montre d’une certaine dureté dans son montage. D’une part, car la structure de Retour au pays est constituée d’allers et retours renvoyant inlassablement les ouvriers vers la ville-usine. De l’autre, car les coupes peuvent être tout aussi abruptes lorsque Wang Bing filme le retour à la terre natale. Une incroyable et longue séquence de mariage contient par exemple un raccord d’une brutalité inouïe entre la fête qui bat son plein (les fils serpentins fusent dans tous les sens, y compris sur la caméra) et une chambre à la lumière blafarde, dans laquelle les mariés sont assis au bord du lit, sans échanger un mot, avant que l’homme ne soit pris d’une quinte de toux. Au-delà du fait que l’articulation des deux plans dépassionne le portrait conjugal, ce rappel de l’intérieur bétonné, alors que le mariage se déroulait jusqu’ici à l’air libre de la montagne, synthétise l’horizon bouché du couple, destiné à retrouver encore d’autres chambres sombres à des milliers de kilomètres de là. La suite des festivités, avec la réverbération excessive d’un micro de karaoké, se voit ainsi teintée d’une gravité nouvelle malgré les pas de danse joyeux et appliqués d’une gamine lancée dans une choré façon TikTok.
À défaut d’entrevoir la possibilité d’une amélioration de leurs conditions ou même de lutter contre la structure qui les opprime, le cinéaste aura permis à ces travailleurs migrants, adultes ou ados, efficaces ou lents, économes ou gaspilleurs, d’imprimer leur nom à l’écran. C’est le seul élément ajouté aux images glanées pendant plusieurs années de tournage : les patronymes de ces invisibles qui produisent les vêtements du capitalisme mondialisé, Lin Shao, Fang Lingping, Xiao Wei, ou encore Qing Tao. Leurs noms, suivis des liens familiaux (« frère de », « cousine de », etc.), se multiplient sur l’écran tout au long des trois films, au point qu’il est à peu près impossible de s’en rappeler précisément. Il s’agit au fond moins de « documenter », au sens premier du terme, que d’ériger une stèle, un monument sous la forme d’un film de dix heures, avec ce que la chose implique d’écrasant et de répétitif (on se souvient des sièges qui claquent au Festival de Cannes lors de la présentation du premier volet). Le périple se termine sur un hors-champ en forme d’abyme : un ouvrier, derrière sa machine à coudre, qui porte un masque. L’image (l’une des dernières tournées par Wang Bing) date de 2019 et n’a rien à voir avec le COVID-19 (ce n’est pas la première fois de la trilogie que l’on voit un ouvrier avec un masque), mais ainsi placée elle convoque le souvenir de la pandémie, qui débutera quelques mois plus tard. On ne saura pas ce que sont devenus ces exilés dans la Chine confinée.
Critikat